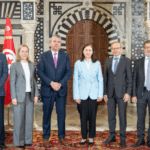Par-delà la chute du régime et l’entrée dans l’ère post-Ben Ali, les élections d’octobre 2012 avaient consacré le premier véritable tournant depuis l’indépendance. Elles ont permis à une coalition inédite de parvenir au pouvoir, entérinant la mort du monopartisme qui a dominé pendant plus d’un demi-siècle la vie politique tunisienne. Cette triple modification devait normalement traduire un changement profond de la société, de la pensée politique et des modes de gouvernance. Sans cela la Tunisie risquait de devenir un pays difficile à gouverner. Il ne faut pas être un politologue chevronné pour remarquer que par leur vote pour une idéologie parfaitement allogène, les Tunisiens avaient opté pour un plongeon dans l’inconnu. C’est que, dans leur hâte de se débarrasser des icônes de l’ancien régime, ils souhaitaient avant tout que l’on donne un nouveau visage à la politique, nonobstant les programmes qui poussaient inévitablement à la surenchère de promesses ou à des alliances contre nature, comme celles de ces deux partis complétant une Troïka qui, dans leur soif de pouvoir, avaient honteusement trahi leurs électeurs pour s’acoquiner avec les vainqueurs du scrutin.
Le soulèvement du 14 janvier aurait dû constituer l’amorce d’une rupture avec les méthodes du passé. On s’attendait en effet à la mise en place de nouveaux modes de pilotage ou de régulation, fondés sur un partenariat ouvert et éclairé, entre différents acteurs et parties prenantes, qu’ils rendraient la société plus harmonieusement gouvernable, l’action publique plus efficace et proche de l’intérêt général. Malheureusement, un tel plan n’a jamais frôlé l’esprit des nouveaux chefs et la rupture n’a, en définitive, jamais eu lieu. On a reproduit les mêmes schémas de gestion des affaires du pays, on est resté obstinément enfermés dans le carcan des vieux discours, des vieilles méthodes, conservant les oripeaux d’un mode de gouvernement éculé, entérinant de vieilles organisations. Bref, enclenchant pour l’avenir une véritable machine à perdre.
Tout commence avec l’incapacité du gouvernement Caïd Essebsi, qui avait pourtant les moyens de frapper vite et fort, à transformer le pays en imaginant de nouvelles structures, en appliquant une nouvelle organisation dans l’aménagement des pouvoirs régionaux et locaux. Survint ensuite le double échec des islamistes au pouvoir : le premier dans la pratique de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui a précipité leur départ du gouvernement. Le second a eu des répercussions nettement plus dramatiques sur les conditions économiques, sociales et culturelles du pays, aggravant la crise, déstructurant l’administration sans parler de la montée de l’extrémisme religieux. En arrivant aux affaires, les islamistes avaient, quoi qu’on en dise, trouvé un pays qui disposait d’infrastructures, du capital humain, des conditions générales en termes de santé et d’organisation institutionnelle pour s’assurer une croissance convenable. Tout cela a été bouleversé et dans certains cas laminé. C’est pourtant avec ce legs notoire et essentiel, laissé par lui et ses coéquipiers, que M. Jomaa entend aujourd’hui transformer le pays !
Encore une fois, on s’attendait à voir surgir un nouveau mode de management politique, s’accomplir une cassure irrémédiable avec le passé qui se manifesteraient d’abord par la dénonciation de la politique de la Troïka. Car, il n’y aura jamais de politique efficace sans un retour sur la gestion des islamistes et leur bilan désastreux. Un devoir d’inventaire est donc une nécessité pour tout gouvernement cherchant à construire l’avenir et à préparer l’opinion à des changements drastiques. Le devoir d’inventaire est une pédagogie du changement. Mais, partie prenante de la débâcle islamiste, M. Jomaa s’était vite empressé de tourner la page. Il aura beau faire dans l’avenir des efforts d’adaptation, donner des signes de renouveau, il traînera ce passif comme un boulet.
La rupture est un motif essentiel à la modernité. Une certaine culture de la rupture, que nous ne possédons pas, a animé sous diverses formes le développement de la pensée politique et sociale moderne. Le mot «rupture» suggère une pause dans le statu quo, un événement inattendu et irréversible qui interrompt la continuité des institutions et des pratiques établies ; un événement singulier qui brise la cohérence apparente de l’ordre symbolique et normatif. Les moments de rupture inspirent l’espoir d’un nouveau départ et d’une émancipation. Comment peut-on à la fois vivre la mondialisation- c’est-à-dire une nouvelle phase dans l’intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels, prendre conscience et s’adapter à la complexité du monde et à la nécessaire mutation de nos modèles face aux crises, composer avec la logique des réseaux qui évince celle du territoire- sans se donner une nouvelle identité politique ? Comment fournir force et vigueur à un Etat devenu vulnérable, satisfaire des demandes sociales plus fréquentes, affronter des médias de plus en plus impertinents. Comment agir enfin contre des extrémistes formés et commandés par des organisations en réseau, alimentées par des circuits de financement occultes, rendus possibles par la dérégulation du monde? Autant de situations qui commandent une autre approche de la politique et de son mode de gestion.
C’est le moment de soulever ici la question de la pertinence et du maintien de certaines entités de la Fonction publique. En composant son gouvernement, M. Jomaa a conservé les mêmes ministères, sans égard pour les contraintes budgétaires et sans considération pour leur utilité et leur efficacité. Pourquoi ne pas admettre qu’aujourd’hui certains ministères n’ont plus d’avenir ni de raison d’être et ne sont qu’une vaste organisation de dilapidation de l’argent public, entretenant une armée de fonctionnaires qui vit aux dépens des contribuables ? Pourquoi disposer d’un ministère de la Culture dont le rôle est d’organiser des festivals, ou d’un ministère du Tourisme qui n’a aucune prise sur l’avenir de cette activité ? Expliquons. Depuis l’indépendance, la Culture en Tunisie était le moteur de l’assimilation forcée, à travers un maillage systématique du territoire, en maisons de culture et du peuple. Le ministère portait alors la »culture légitime » contrôlée, surveillée et administrée, distribuant aides et subventions à une clientèle docile ayant fait acte d’allégeance. Ce temps est révolu et la politique culturelle de l’Etat manque de plus en plus de souffle et d’incarnation. Après plus de cinquante ans d’existence, et bien des missions accomplies, le ministère est devenu incapable de se réinventer, de s’adapter et assiste impassible au démantèlement de l’infrastructure culturelle : salles de cinéma disparues, théâtres désertés, galeries d’art concurrencées par le privé, etc. Par ailleurs, de nombreux acteurs autonomes, sans aucun contact avec le Ministère, animent une vie culturelle créative dans le domaine de la musique, du théâtre, de la peinture et du cinéma. Le ministère est aussi devenu une institution en voie de déconnexion de la vie culturelle : télévision, radio et activités multimédias lui échappent totalement. La gestion du patrimoine archéologique est déjà confiée à une agence et l’Etat ferait mieux de céder le reste à l’initiative privée qui fait souvent mieux que lui. Pas plus que la religion, la culture ne devrait être un domaine d’État. Elle est de plus en plus l’expression de la vie, à travers des modes d’expression nouveaux et en évolution permanente. Plus la culture échappe à l’Etat, désormais incapable de se réinventer, plus le ministère s’englue dans la bureaucratie, mobilisant des centaines d’agents et des centaines de millions. Il n’est plus alors qu’une vache à lait subventionnant des ouvrages que personne ne lit, soutenant des pièces de théâtre et des navets cinématographiques.
Les mêmes arguments valent également pour le ministère du Tourisme. Un Office du tourisme national et des offices pour chaque région, qui fonctionneraient avec les décideurs locaux et les agents du secteur seraient nettement plus appropriés et efficaces qu’une structure bureaucratique. De l’Etat, les professionnels du tourisme attendent autre chose que la gesticulation pathétique de leur ministre : stabilité politique, salubrité urbaine, santé publique, civisme de la population, sécurité des personnes et des biens, etc. Bref, des conditions propices à l’amélioration de la viabilité de toute activité économique. Or, que constatons-nous ? Une ministre qui se démène tous azimuts pour insuffler une nouvelle dynamique: égrenant les déclarations, multipliant les apparitions, intensifiant les déplacements, lançant des campagnes de promotion pour vendre l’image du pays, s’affichant elle-même dans des spots publicitaires qui restent sans effet. De quoi serait-elle capable demain ? Charmer les serpents ? Ou continuer à s’agiter inlassablement de gauche à droite, pour paraître dicter la politique touristique ? Mais comme les touristes qu’elle entend attirer, le serpent reste sourd aux sons de son pungi.