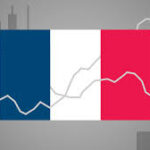Le projet de Loi de Finance 2017 est le lieu d’âpres contestations, notamment de la part de l’UGTT et de l’UTICA, principales forces du paysage social et économique du pays. La Centrale syndicale semble déterminée à voir appliquer l’accord sur les augmentations de salaires en 2017, accord dûment signé par le gouvernement de Habib Essid. Le syndicat patronal refuse la hausse de l’impôt sur les sociétés, à concurrence de 7.5 points, au titre de 2017, voire de 2018.
Par ailleurs, le gouvernement actuel a hérité d’une situation extrêmement dégradée des finances publiques, caractérisée par l’explosion de la dette publique, principalement dans sa composante extérieure, un déficit primaire inquiétant, un dinar en glissement continu par rapport à l’euro et au dollar, alors que les perspectives de croissance sont relativement faibles. Par ailleurs, la conditionnalité de l’emprunt contracté auprès du FMI implique le respect du niveau de la masse salariale par rapport au PIB, négocié en 2016 par l’actuel gouverneur de la Banque centrale et le précédent ministre des Finances.
Cette impasse politique, sociale et économique est particulièrement dangereuse. Si le gouvernement campait sur ses positions, l’affrontement avec l’UGTT serait porteur de tous les périls. Quant aux entreprises, il est à craindre qu’elles seraient acculées à reporter les négociations salariales, prévues en 2016, tout en reconsidérant à la baisse leurs prévisions en matière d’investissement. Si l’Etat reculait, ce serait la fuite en avant, que seul le bon vouloir des financiers des pays du Golfe pourrait la couvrir provisoirement, étant entendu que le FMI bloquerait la deuxième tranche de son prêt, alors que les institutions financières multilatérales et les marchés financiers internationaux deviendraient quasi inaccessibles.
Comment s’en sortir ? Pour cela, il faut accepter le fait qu’à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, susceptibles de surmonter cette impasse et d’éviter le pire.
Rappelons que les bouleversements qu’a connus la finance internationale en 2008, et la crise économique qui s’en est suivie, ont obligé les Etats des pays occidentaux et le Japon à prendre des mesures exceptionnelles et non conventionnelles : création massive de la monnaie centrale, voire de la monnaie scripturale non centrale, alors que ce dernier rôle revient normalement aux banques de second rang ; achats massifs de titres de la dette publique, nationalisation provisoire de grandes banques en difficulté, abandon de la cible du taux d’intérêt par les Banques centrales, au profit d’une cible quantitative élevée (il s’agit du « Quantitative Easing » ou assouplissement quantitatif) ; taux d’intérêt directeur nul, voire négatif pour le taux de la facilité de dépôt ; etc.
Par ailleurs, il y a lieu d’insister sur le fait qu’en période de crise des finances publiques, un plan de redressement ne concerne pas seulement la politique budgétaire, mais plutôt la politique économique dans sa globalité, c’est-à-dire impliquant notamment la politique monétaire, la politique commerciale et la politique de croissance. Et c’est bien là le défaut majeur du projet de Loi de Finances 2017.
Pourtant, mise à part la situation dramatique des finances publiques, essentiellement due à une gouvernance plus que laxiste depuis 2011, les observations ci-après auraient dues être prises en considération (pour plus de détails, se référer à mon article « Pour une politique économique non paradoxale », paru dans l’Economiste maghrébin n° 694 du 5 ocotbre 2016).
- L’économie est en situation de stagflation depuis 2011, et l’écart entre la production potentielle (qui baisse depuis 2011 à cause de la diminution des productivités du capital et du travail) et la production effective s’élargit, aggravant de ce fait le taux de chômage.
- Comme on le sait, le dinar n’étant pas convertible totalement (seulement la convertibilité courante), on ne peut dès lors espérer qu’un taux d’intérêt élevé fasse affluer les capitaux étrangers et soulager la contrainte sur les devises ainsi que la pression sur le taux de change.
- Le déficit des paiements courants est très élevé et les exportations de marchandises réagissent marginalement au glissement du dinar, alors que la demande extérieure reste atone.
- L’inflation est fondamentalement une inflation par les coûts. Comme il n’y a pas d’arbitrage entre inflation et chômage (absence de courbe de Philips où la diminution du chômage implique la hausse de l’inflation), la Banque centrale peut avoir à la fois un objectif d’inflation modérée et d’augmentation de l’emploi, d’autant plus que l’influence du taux directeur de la Banque centrale sur la croissance des prix est très faible.
- Mise à part l’incertitude, l’investissement des entreprises privées et publiques peut difficilement retrouver des couleurs, quand le coût unitaire du salaire pour les sociétés non financières a augmenté en moyenne plus vite que leur prix sur 2011-2014 (plus de 2% de différentiel de croissance, ce qui correspond au différentiel de croissance entre le salaire réel et la productivité du travail) ; et que leur taux de marge brut baisse de 12% entre 2010 et 2014, faisant chuter dramatiquement leur taux de cash-flow (-18% par rapport à 2010 et -40% par rapport à sa moyenne sur 2001-2008). A cela vient s’ajouter des taux d’intérêt effectifs à court, à moyen et à long termes, élevés et croissants depuis 2012, alors que les investissements massifs de l’Etat en infrastructures, notamment dans les régions défavorisées, tardent à venir.
- Le coût de refinancement des banques ne décourage pas l’offre de crédit. Quant au refinancement, son niveau est devenu quasi structurel et tourne quotidiennement autour de 7 milliards de dinars.
- La variation de la masse monétaire (M3) depuis 2011 a pour contrepartie, de plus en plus, la variation des créances sur l’Etat, de moins en moins celle du concours à l’économie, et encore moins celle des créances nettes sur l’extérieur.
- Il semble donc paradoxal de maintenir les taux d’intérêt effectifs moyens aux niveaux actuels. Il est tout aussi paradoxal de miser sur une plus grande flexibilité du dinar pour contenir le déficit extérieur. Il est également paradoxal que le financement des non-professionnels se situe à un niveau aussi élevé (près de 31%). Il est enfin paradoxal que les salaires des sociétés non financières augmentent à un taux supérieur ou égal à l’inflation, alors que la croissance de la productivité du travail est en moyenne négative sur 2011-2015.
Eu égard à ce qui précède, nous proposons les mesures suivantes :
- La monétisation du tiers de la dette publique intérieure, soit près de 6 milliards de dinars. Il s’agit du rachat par la Banque centrale des Bons du Trésor détenus principalement par les banques, à concurrence de ± 6 milliards, et les détruire de manière équivalente. Cette « vraie » monétisation crée de la monnaie, en gonflant notamment les réserves excédentaires des banques auprès de la Banque centrale. Cette opération ne serait pas inflationniste, puisque elle permettrait de diminuer fortement le recours des banques de second rang au refinancement. Elle permet également aux banques et aux investisseurs institutionnels d’acquérir les nouveaux BTA (les bons de trésor assimilables émis par l’Etat pour financer une partie de son déficit budgétaire 2017), sans contrainte de liquidité. Le surcroît de liquidité détendrait le marché monétaire et faciliterait la distribution de crédit aux PME. Au demeurant, l’emballement éventuel du crédit peut être contenu par la variation du taux des réserves obligatoires.
- Cette monétisation ne peut se réaliser qu’en modifiant l’article 10, alinéa 1), premier point de la loi du 25 avril 2016 relative au statut de la Banque centrale. Il s’agit d’autoriser cette dernière, exceptionnellement en 2017, d’acheter des titres publics et de les détruire, à concurrence de ± 6 milliards de dinars.
- Cette opération permettrait de diminuer sensiblement l’encours de la dette publique et, partant, ferait économiser à l’Etat plus de 1 milliard de dinars, au titre du service de la dette publique intérieure en 2017, et un peu moins en 2018.
- Ces ressources supplémentaires pourraient permettre de financer la moitié de l’équivalent des augmentations de salaires dans la fonction publique, initialement prévues en 2017 (qui serait l’exigence du gouvernement). Ainsi, l’effort requis par les fonctionnaires serait très sensiblement modéré. En revanche, on ne toucherait pas au barème de l’impôt sur le revenu, sauf éventuellement pour les très hauts revenus qui seraient imposés au taux de 40%.
- L’équivalent des augmentations de salaires serait perçu à travers le crédit d’impôt, et non pas en majoration directe des rémunérations dans la fonction publique. Ce faisant, la contrainte exigée par le FMI serait respectée.
- Ces ressources supplémentaires permettraient également de revoir l’augmentation proposée de l’impôt sur les sociétés, pour la situer au niveau de 30%.
- L’effort fiscal devrait surtout porter sur les forfaitaires, les professions libérales et sur l’impôt sur le patrimoine qui devrait être « réellement » instauré en 2018. Ce dernier est un instrument relativement efficace pour lutter contre la forte inégalité dans la répartition des richesses ainsi que contre le blanchiment de l’argent. Selon l’OCDE, l’impôt sur le patrimoine représentait en 2014 près de 1.1% des recettes totales de l’Etat tunisien, contre près de 8% en Belgique, 11% au Canada, 5% au Chili, 10% en Corée, plus de 12% aux Etats-Unis, 9% en France, 8% en Grèce, 7% en Irlande, 7% en Italie, 5% en Pologne, 4% au Portugal et une moyenne d’environ 6% pour les pays de l’OCDE. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le secteur des micro-entreprises ou secteur informel localisé (0 à 5 salariés) représente près de 95% des entreprises privées, la moitié de leur emploi et 12% de leurs salariés. Dans ce secteur prédomine le travail indépendant, soit près de 85%, ainsi que le travail en noir. Enfin, ce secteur contribue, selon l’INS, pour au moins 10% du PIB, ce qui ne serait pas négligeable en termes d’assiette d’impôt.
- Pour un pays qui se doit d’économiser l’énergie et diminuer la pollution atmosphérique, les prix de l’essence et du gasoil devraient être revus à la hausse, loin des contraintes du « fameux » mécanisme d’ajustement automatique de ces prix. En contrepartie, le gouvernement devrait combattre le marché parallèle des carburants qui représente aujourd’hui 30% du marché total de pétrole en Tunisie. Par ailleurs, près de 23% de la compensation des produits alimentaires sont transférés hors ménages (restauration, cafés, tourisme, etc.), et il n’y a aucune raison de ne pas récupérer cette subvention par les taxes.
- L’impôt de 10% sur les entreprises totalement exportatrices devrait être maintenu, sachant par ailleurs que les entreprises off shore réalisent des gains par le seul fait du glissement du dinar contre l’euro (c’est la « tarification au marché » qui bénéficient à ces entreprises, dont 90% de leurs échanges sont facturés en euro, et qui représentent 65% des exportations de marchandises alors que leurs importations ne dépassent pas 60% de la valeur de leurs exportations).
- La réduction significative du déficit primaire de l’Etat, autour de 1% en 2018, est incontournable. Elle permettrait de limiter le recours à l’endettement public.
- La baisse sensible et progressive du taux directeur de la Banque centrale serait nécessaire. Elle aurait pour effet de faire baisser les taux d’intérêt effectifs à court, à moyen et à long termes, et de relancer le crédit aux professionnels, notamment pour l’investissement. Elle aurait aussi pour effet de diminuer les taux d’intérêt sur les titres publics, soulageant ainsi le service de la dette publique intérieure.
- La tension sur les réserves de change, consécutive au déficit de la balance courante, ne pourrait être réduite significativement, à court terme, par la seule baisse du déficit budgétaire. A cet égard, il y aurait lieu de contenir les importations, par l’intermédiaire des pratiques auto-limitatives de l’administration, en concertation avec les professionnels. Evidemment, cette cible viserait l’importation des biens de consommation qui représentaient en 2015 plus de 25% des importations totales de marchandises, soit près de 10 milliards de dinars. Elle viserait également une meilleure gouvernance des importations (d’après la Banque centrale et durant les trois dernières années, les quantités importées de céréales, de café et de sucre dépassent largement l’évolution normale de nos besoins). Cela permettrait d’atténuer sensiblement le glissement du dinar, et, partant, agirait sur l’inflation.
- La décélération des prix et la relance de l’investissement nécessiteraient, durant 2017 et 2018, une désindexation des salaires sur l’inflation. Ceux-ci continueraient d’augmenter à un rythme inférieur aux prix de production, afin d’améliorer le taux de marge et le cash-flow des sociétés non financières, facteur important de la relance de l’investissement et de l’augmentation de l’épargne intérieure.
- En contrepartie de l’effort requis, l’Etat devrait consacrer un maximum de ressources pour les investissements en infrastructures dans les régions défavorisées, quitte à vendre une partie de ses actifs les plus liquides.
Au total, l’interdépendance entre la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique commerciale et la politique de croissance est organique. Il ne peut y avoir de redressement durable des finances publiques sans une approche globale et non paradoxale de la politique économique.