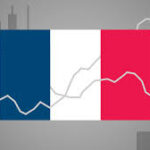Drôle d’époque. On assiste partout à une véritable inversion des valeurs. Déjà que la valeur travail passe à la trappe, supplantée qu’elle est par les nouvelles valeurs dominantes celles de l’argent. Exit l’industrie, souci d’innovation et le besoin de compétitivité ! Gloire à l’import par voie légale ou par les chemins détournés, tortueux, sinueux, immergés, mais qui n’en ont pas moins pignon sur rue au grand dam du secteur structuré qui n’en finit pas de battre en retraite.
Nos entreprises industrielles, socle de notre avenir sont à l’agonie alors même qu’elles sont stigmatisées, harcelées, soumises au feu roulant de revendications salariales qu’elles ne peuvent satisfaire ni supporter. Des revendications à sens unique, sans réelle contrepartie productive. La productivité décline, l’impératif de compétitivité et de qualité s’estompe sous le vacarme d’agitations et de protestations permanentes. L’UGTT mène le bal, fait semblant de s’en défendre et laisse faire quand elle n’est pas elle-même à la manœuvre. L’UTICA subit et n’arrive même plus à donner de la voix.
Dans quelle époque vivons-nous ? Notre courbe d’horizon s’est considérablement rétrécie. La vérité est que nous n’avons plus de visibilité. L’épargne nationale fond comme beurre sous le soleil, au profit de la consommation pour ceux qui le peuvent encore. L’investissement régresse sous la charge de la spéculation. Nous avons fait du très court terme notre principale idéologie. « Tunisie 2020 » c’est si loin et pourtant si proche de nous , horizon si indécis, si improbable qu’on n’ose même pas y penser. Tout et tout de suite. Ici et maintenant.
L’inversion de l’échelle des valeurs est totale. En témoigne notre attitude à l’égard du budget et de la loi de finances. Nous n’avons plus la même perception du budget qui passe pour ainsi dire au second plan, alors qu’il est l’expression même de nos préférences nationales de structure. Rien de moins qu’un plan annuel de développement pour bannir les effets du hasard et de l’incertitude. L’Etat y décline ses principales orientations économiques, sociales et financières. Le budget pose par nature les bases de la politique de l’Etat, traduit son degré de volontarisme et sa capacité de réguler l’économie et les marchés qu’il faut avoir sous contrôle. C’est la raison pour laquelle nous avons su et pu pendant longtemps nous maintenir sur un trend de croissance qui, s’il n’est pas très fort de type asiatique, nous a permis d’éviter les fluctuations cycliques et les risques de dépression propres aux économies non régulées.
Les professionnels de l’économie, clients, fournisseurs ou sous-traitants pour le compte de l’Etat, pourtant allergiques à l’impôt, cherchaient leur salut et leurs opportunités d’investissements davantage dans l’analyse du budget que dans la critique du projet de loi de finances qui, pourtant, ne les épargne guère.
Six années de croissance molle, atone, proche de zéro sur fond d’incertitudes ont abîmé notre appareil productif et ébranlé la conviction d’un grand nombre d’entreprises, et pas seulement de PME-PMI. Les temps sont désormais durs pour les entreprises en perte de dynamisme, d’agressivité commerciale à l’international, comme au plan local. Les salariés ne sont pas logés à meilleure enseigne en dépit des hausses de salaires vite rattrapées, cannibalisées pour ainsi dire par la hausse des prix qui n’en finit pas de gangrener le tissu social. Il n’est pas étonnant que dans un tel contexte, dans des conditions de survie aussi difficiles, les préoccupations de court terme prennent le pas sur les considérations de moyen ou de long terme. Celles-ci sont de peu d’importance pour les entreprises au bord de l’asphyxie financière ou pour les salariés qui ont des fins de mois de trois semaines. Résultats des courses : Le budget de l’Etat, fondé sur les prévisions économiques annuelles, n’intéressent au mieux que les députés de l’ARP. En revanche, celles et ceux qui produisent, créent, inventent, innovent, se battent pour leur survie, vivent désormais sous la hantise de la loi de finances. Ils savent à quel point les finances publiques sont dégradées, la collecte d’impôts difficile en l’absence de croissance. Et ils redoutent d’en faire les frais et d’en payer le prix fort. La moindre révision des prix à la hausse ( carburant, vignette, timbre de voyage, produits de consommation courante), le moindre ajustement fiscal tout aussi à la hausse avec pour effet d’accroître la pression fiscale (TVA, IR, IS), toute augmentation des charges patronales aussi minime soit-elle, ajoutent à leur colère et à leur exaspération, à leur abattement et peut-être aussi à des réactions pour le moins imprévisibles.
Le projet de loi de finances 2018, avant même son annonce officielle, a déclenché l’ire, hostilité des salariés, des retraités, des dirigeants d’entreprises qui ne s’en cachent plus et bien évidemment de l’ensemble des professions libérales qui ont plus d’une fois fait reculer et fléchir l’Etat. Réussiront-ils à l’obliger de nouveau à revoir sa copie fiscale ? Les prochains jours nous le diront.
Une chose paraît quasi certaine : nous nous approchons en matière de prélèvement fiscal, de la ligne de danger qui, si elle est franchie, fera que tout peut alors basculer du mauvais côté. La situation des entreprises et des ménages, à quelque niveau de revenus qu’ils soient, est telle qu’il n’y a plus beaucoup de place, ne serait-ce que pour les ajustements fiscaux à la marge, pas même pour les réglages fins, à moins de les envisager à la baisse. Il faut se garder des schémas éculés qui n’ont plus cours. Il ne faut pas se tromper en s’imaginant que la lassitude voire la résignation des acteurs économiques et sociaux finiront par l’emporter. On ne peut prédire de leur réaction et tout peut arriver. L’Etat gagnerait, il est vrai, moins en s’imposant le principe de précaution, mais il y a beaucoup à perdre à vouloir trop forcer le trait de l’audace en chargeant la barque fiscale. Il arrive un moment où la hausse des taux sape la consommation et décourage l’investissement. Les recettes augmenteraient dans l’immédiat pour décliner aussitôt après pour avoir altérer deux des principaux moteurs de la croissance que sont la demande de consommation et d’investissement. Sans verser dans le « déclinisme », on ne peut ne pas craindre que cela ne se produise.
Dans l’urgence, les choix sont toujours difficiles et les mesures à prendre relèvent elles aussi de l’urgence. Les caisses publiques sont désespérément vides alors que la demande de transferts sociaux n’a jamais été aussi élevée. L’Etat n’a pu, ces derniers temps, exercer ses attributs et ses fonctions régaliennes qu’en recourant à l’endettement, qui croît de manière exponentielle, au regard du recul des exportations, des recettes touristiques et de la dépréciation du dinar. Le poids de la dette extérieure et du déficit budgétaire, devenu insoutenable, inhibe toute velléité de croissance. Il faut nécessairement briser ce cercle vicieux et enclencher un cercle vertueux en rationalisant les dépenses de l’Etat et en mettant de l’ordre dans ses finances.
Au stade où nous en sommes, l’Etat peut encore réformer avant d’être contraint de le faire par l’extérieur, l’humiliation en plus. Pour dire les choses comme elles sont, les bailleurs de fonds, notamment le premier d’entre eux le FMI, s’invitent dans le débat qui tourne, à mesure que la situation se dégrade, au diktat : réformes contre crédits, sinon rien. Et pas que de simples réformettes ou de simples réajustements cosmétiques. Il faut des mesures de fond et une action vigoureuse de l’Etat pour contenir la dette et réduire le poids des déficits, à défaut de rétablir l’équilibre économique et financier.
Le gouvernement est face à un choix cornélien, un terrible dilemme : augmenter les impôts, charges et cotisations sociales, c’est à dire le contraire d’une politique d’offre, pourtant si nécessaire, ou tailler à la machette dans les dépenses publiques et les transferts sociaux.
On dira toujours qu’il a la possibilité d’augmenter ses recettes fiscales sans en relever le taux, en élargissant l’assiette. A charge pour lui de s’attaquer à l’évasion fiscale, à la corruption, à intégrer au régime réel les 400.000 forfaitaires et les circuits parallèles qui n’en sont pas moins des fraudeurs patentés. L’ennui est qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Il faut du temps, beaucoup de pédagogie et de moyens pour y parvenir alors que le gouvernement fait face à l’urgence.
Ce qui, du reste, ne l’exonère pas d’effort : il en apporte lui même confirmation à l’annonce du gouvernement de guerre. Quant à réduire la voilure de l’Etat et couper dans les dépenses, les choix sont tout aussi difficiles dans la Tunisie post-janvier 2011. Jusqu’où et comment faut-il sabrer ?
Il y a certainement des économies à faire en rationalisant les subventions à la consommation, en réduisant le train de vie de l’Etat et en dégraissant le mammouth. Ici aussi, il faut beaucoup de discernement et du temps pour aller jusqu’au bout de ce processus. Le problème est qu’il faut dans l’immédiat, davantage de ressources, afin que l’Etat puisse payer ses fonctionnaires, rembourser le service de la dette et engager les nécessaires investissements d’avenir. Comment s’y prendre ? Il n’y a rien de mieux à faire, sans nuire au reste de l’économie, que d’amorcer la privatisation d’entreprises publiques dont rien ne justifie le maintien dans le giron de l’Etat. Celles, en tout cas, qui n’ont pas vocation à fabriquer les déficits, au plus grand bonheur de leurs effectifs pléthoriques. Au nom de quoi ferait-on saigner les contribuables pour maintenir ces entreprises artificiellement en activité ? Si elles venaient à être privatisées, elles gagneraient en efficacité, créeraient davantage de vrais emplois, ne coûteraient plus rien à l’Etat et lui paieraient plus d’impôts qu’elles ne l’ont jamais fait. L’écueil syndical n’est pas aussi insurmontable qu’il n’y paraît. L’UGTT « comprendra » si elle n’est pas totalement exclue du banc de la privatisation.
Seul bemol, c’est que même dans ce cas, qui ne heurte pas la demande de transferts sociaux, l’Etat ne pourrait engranger dans l’immédiat les bénéfices d’une telle opération Ses effets seront en effet forcément étalés dans le temps alors qu’il faut impérativement disposer de moyens financiers, autrement qu’en recourant à la dette pour boucler le budget.
Une chose est sûre : il vaut mieux couper dans les dépenses superflues que d’accroître la pression fiscale. La fiscalité doit retrouver sa vocation originelle : favoriser les transferts sociaux et encourager l’investissement et l’épargne. Sans quoi, on verra surgir à l’horizon le spectre de la récession. Le pays a impérativement besoin d’un budget de relance : un peu moins d’impôts sur les sociétés et sur les revenus, un peu moins d’Etat dans le secteur concurrentiel, plus d’investissements même s’ils sont en partie financés par un surcroît d’endettement. N’ayons pas peur de la dette, du déficit budgétaire quand c’est pour la bonne cause : financer les infrastructures et construire l’avenir.
Ce n’est pas tant le niveau de la dette on du déficit budgétaire qui inquiète, c’est surtout l’absence d’une croissance forte et durable qui fait peur. A marée haute, quand monte le niveau de la mer, toutes les entreprises sont de nouveau à flot, les caisses de l’Etat ne seront pas les dernières à en profiter.