Le monde d’aujourd’hui est en transition continue. Un monde plus complexe, dérégulé et en profonde mutation. L’analyse et la compréhension de l’identité géopolitique sont loin d’être apaisées. Mehdi Taje, Président de l’Institut de Veille et d’Analyse Stratégique et Prospective (IVASP) donne un éclairage des enjeux stratégiques du présent et de l’avenir. Interview:
leconomistemaghrebin.com : Quelle est donc l’identité géopolitique du Maghreb, notamment en Tunisie ?
Mehdi Taje : La Tunisie est confrontée à court terme à un ordre régional déphasé, fragmenté, instable et imprévisible, marqué par la montée des tensions et des inégalités dues à la transition démocratique, susceptibles. Selon l’évolution de la situation, d’aboutir à une reconfiguration de la carte régionale.
Les développements inégaux au sein du Maghreb et les nouvelles tensions affaiblissent l’ensemble de la région. Et aggravent ainsi sa dépendance économique et sécuritaire. En effet, lorsque les pays construisent leur sécurité et leur économie hors du Maghreb. Le berceau commun cesse d’être le garant d’une prospérité et d’une sécurité partagées. De grands enjeux s’attachent à la réalisation du Grand Maghreb : enjeu de croissance et de prospérité, enjeu stratégique, enjeu de civilisation. Le Maghreb uni serait plus fort. Le Maghreb pourrait accéder à un ordre de puissance économique et stratégique. Et ce, en mesure d’assurer la prospérité et la sécurité de ses peuples. Et de peser dans le règlement des conflits qui affligent le Machrek. Et qui retardent notamment le règlement de la question palestinienne.
Plus au fond, le Grand Maghreb pourrait constituer avec les pays du Sahel une même région économique, dotée d’immenses ressources, parlant les mêmes langues et ouverte au marché mondial : espace 5+5+5. Car seul un Maghreb uni est en mesure d’aspirer à l’essor culturel et scientifique, de contribuer au nom du monde arabe au progrès de la science, des arts et de la culture et de restaurer la grandeur de la civilisation islamique.
Qu’en est-il du repositionnement de la politique étrangère en Tunisie ?
Il est dicté par le chambardement des relations internationales et des équilibres de puissance à l’échelle planétaire. Pour comprendre ce qui se passe dans notre région au niveau géopolitique, il faut d’abord bien comprendre ce qui se passe et ce qui est en train de se passer au niveau planétaire : une sorte d’exacerbation des rivalités est en cours entre les puissances occidentales visant à maintenir les Etats-Unis en tant que moteur de la transformation du monde et les forces émergentes œuvrant à l’avènement d’un monde multipolaire (Chine, Russie, Inde, Iran, Brésil, etc.)
La tendance est à l’érosion du leadership américain et « la bagarre multipolaire » est engagée selon les propres termes d’Hubert Védrine. Ils bâtissent des projections géopolitiques d’envergure et des représentations collectives de l’avenir.
Avant, on parlait d’un jardin à la française, du temps de la Guerre froide. Du coup, le déchiffrage du jeu des acteurs et de celui des puissances était assez simple. Aujourd’hui, le jeu des puissances est devenu d’une complexité absolue. Des alliances se font et se défont, la mondialisation piétine, le multilatéralisme bascule.
Le Brexit, l’élection du Président Donald Trump aux Etats-Unis, la montée des extrêmes droites révèlent une nouvelle tectonique des plaques et une remise en cause du modèle dominant : la mondialisation. L’individu, dilué et ayant perdu ses repères, aspire à retrouver les fondements de son identité. Le rejet de « l’Autre » n’est que la manifestation de la résurgence de cette quête. Dans ce contexte, la globalisation, bousculée et remise en cause, se grippe, piétine. « La fin de l’histoire » fait place à un retour en force de l’histoire, de la géographie, de l’Homme, bref de la géopolitique.
Est-il difficile d’analyser le jeu des grandes puissances ?
Face à la percée des puissances rivales menaçant l’hégémonie américaine, il incombe pour l’Etat profond américain d’être en mesure de fragmenter le monde musulman selon des lignes religieuses et communautaires afin d’entretenir une zone d’instabilité durable sur le flanc sud de la Russie et de menacer la sécurité des approvisionnements énergétiques de la Chine, la politique de rollback (refoulement) vis-à-vis de la Russie et celle de confinement (Containment policy) de la Chine. L’instrumentalisation de l’islamisme radical vise clairement à affaiblir ces acteurs menaçant l’hégémonie américaine.
Or l’hégémonie américaine n’est pas forcément l’Administration Trump, car il n’y a pas une Amérique, il y a des Amériques et des centres de pouvoir. Certains centres de pouvoir aspirent toujours à la sauvegarde de l’hégémonie américaine à l’échelle planétaire avec leurs alliés tels que la Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, la Grande-Bretagne veut s’ouvrir sur le large et non plus être cantonné dans l’UE. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si elle parle de l’ouverture de deux bases militaires une en Amérique latine et une autre en Asie du Sud-Est.
Comment voyez-vous les forces en présence pour le cas de la Syrie ?
Aujourd’hui, les forces se sont interposées. Le cas de la Syrie en est un exemple. C’est grâce à l’intervention russe qui a freiné la mise en place d’un plan qui était conceptualisé par certaines officines américaines. Même si ces plans existent toujours.
Les Américains pensaient que la Syrie basculerait de la même manière que la Libye, mais ils ont sous-estimé toute une série de paramètres (la résistance d’un régime lui-même, la structure sociale de la Syrie, le communautarisme syrien, la complexité de la mosaïque syrienne). Ils pensaient que les Sunnites constituaient un bloc. Or, la bourgeoisie sunnite s’est opposée à l’arrivée des sunnites radicaux…
Et puis, il y a eu la contre-manœuvre avec l’intervention des Russes dans une moindre mesure accompagnée par le soutien des Chinois.
Comment voyez-vous la restructuration du voisinage ?
Maintenant, ils sont en négociation pour le Moyen-Orient et le Maghreb. Cela dit, il faut revenir à celui qui incarne le plus la nouvelle doctrine géopolitique des rapports de force à l’échelle planétaire.
C’est Thomas Barnett, professeur au Pentagone, élève d’un Amiral, affirmait que pour maintenir leur hégémonie sur le monde, les États-Unis devraient « faire la part du feu », c’est-à-dire le diviser en deux. D’un côté, des États stables (les membres du G8 et leurs alliés). De l’autre, le reste du monde considéré comme un simple réservoir de ressources naturelles. À la différence de ses prédécesseurs, il ne considérait plus l’accès à ces ressources comme vital pour Washington. Mais prétendait qu’elles ne seraient accessibles qu’aux États stables.
En clair, le raisonnement de Barnett c’est celui de se resituer dans le cadre d’une néo conférence de Berlin avec des deals et des partages de zones abritant des ressources stratégiques dans le cadre d’émiettement et de fragmentation d’Etats et de régions.
Thomas Barnett : « Bien sûr, on commencera par tel ou tel pays, mais on favorisera la contagion… »
Une des grandes ruptures entre la pensée de Barnett et celle de ses prédécesseurs, c’est que la guerre ne doit pas être menée contre des États particuliers pour des mobiles politiques. Mais contre des régions du monde parce qu’elles ne sont pas intégrées dans le système économique global. « Bien sûr, on commencera par tel ou tel pays, mais on favorisera la contagion, jusqu’à tout détruire comme on le voit au Proche-Orient élargi ».
Dès lors, il convenait de détruire systématiquement toutes les structures étatiques dans ce réservoir de ressources, de sorte que personne ne puisse un jour ni s’opposer à la volonté de Washington, ni traiter directement avec des États stables. Une théorie qui peut être résumée en ce sens : il y a ce qu’on appelle les « Integrate States » et les «Non-integrate States » (le réservoir des ressources naturelles).
Pour lui, la stratégie est simple, les États stables (Integrate States) doivent pouvoir puiser dans le réservoir à moindres frais.
Pour pouvoir y parvenir, il faut maintenir ce réservoir dans un état chaotique, en créant le chaos. Et pour que l’armée américaine puisse se rendre indispensable. Y compris auprès de ses alliés pour aller puiser dans les ressources. L’enjeu est donc l’accaparement des ressources. Aussi bien pour les pays stables (le bloc occidental) que pour les pays instables (le reste du monde).
D’ailleurs, si les Américains viennent de voter une loi pour réactiver le partenariat transsaharien en vue de lutter contre le terrorisme. C’est uniquement pour ne pas abandonner l’espace au monopole français.
Pour le cas de la Libye ?
On arrive à une rivalité entre l’Italie et la France. C’est apparent. Mais pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui, les deals se font entre puissances. L’enjeu est clair: il y a une entente pour balkaniser les Etats. D’où la fin de l’ordre Westphalien. Autrement dit, il s’agit d’un nouveau partage du monde.
La problématique libyenne se résume à cette question :
Quelle est l’articulation entre le pouvoir local et un semblant de pouvoir central quant au partage et au contrôle des richesses pétrolières et gazières. Et celui du pouvoir politique
Quelles sont les chances du Maréchal Hafter, le Président du Conseil Présidentiel du Gouvernement Libyen d’Union Nationale, Fayez Sarraj, en Libye ?
Pour le moment, ils sont dans une situation d’impuissance. Il est vrai que du côté de l’Est, Hafter contrôle la Cyrénaïque. Il contrôle également le croissant pétrolier. Ce qui lui donne un ascendant. Il ambitionne bien évidemment d’éliminer Daech, de prendre le contrôle du sud et enfin marcher sur Tripoli. Ce sont ses ambitions. Cela dit, je n’ai pas dit qu’il allait y arriver parce qu’il est soutenu par des acteurs régionaux et internationaux.
Quant au camp adverse, lui-même est soutenu par des acteurs régionaux et internationaux. En réalité, Faiez Sarraj ne représente que lui-même. Et on le voit d’ailleurs. Il est pris en otage par un cartel de milices. Il leur doit son salut, les miliciens sont payés par des ministres qui puisent dans les fonds publics libyens. Mais ils obéissent aux chefs de milices. C’est la nouvelle féodalité territoriale.
Peut-on parler d’une paix dans la région Mena ?
Je ne la vois pas. Au contraire, si on analyse objectivement la situation après l’échec de l’entité territoriale de Daech (en réalité il s’agit d’un plan américain : le Sunnistan tracé dans la carte de Robin Wright datant 2013). Les Américains ont compris que l’instrumentalisation de l’islam politique et du terrorisme dans cette région n’est pas la bonne carte à jouer. De plus, avec l’intervention russe, ce n’est plus matérialisable. Du coup, ils ont basculé vers la carte kurde. Quant à Daech, ce sont les nouveaux mercenaires du 21ème siècle.
Quelles sont les craintes quant au retour des foreign fighters ?
Dans la mesure où il reviennent en Libye, c’est à la fois pour déstabiliser la Libye. Mais si ce sont des Tunisiens qui reviennent en Libye. Ils ne vont pas, à mon avis, rester très longtemps là-bas. Car le risque est qu’ils ciblent le territoire tunisien depuis la Libye. Mais aussi qu’ils arrivent à constituer des camps d’entraînement en Libye pour établir une jonction avec les éléments qui se trouvent à Mont Semmama et Mont Chaambi etc.
Il faut absolument briser toute connexion. L’Algérie aussi est menacée par l’installation des djihadistes dans le Sahel profond.
Quel est l’intérêt de viser l’Algérie ?
L’Algérie est la 3ème réserve mondiale en termes de ressources naturelles. C’est un potentiel formidable et facilement exploitable. Donc cela attire les convoitises des uns et des autres
Que pensez-vous de la tournée du Ministre des Affaires Etrangères Sergueï Lavrov dans le Maghreb ?
A mon avis, il est venu en Algérie pour offrir son soutien et s’assurer que la transition se fasse dans de bonnes conditions. Et ce, d’autant plus qu’un officiel algérien (M. Kacimi) est convaincu que l’Algérie est ciblée par un complot international fomenté par des Etats – y compris arabes – qui veulent la déstabiliser. Ce plan de déstabilisation consiste à faire entrer par la frontière sud des éléments terroristes. En les mêlant notamment aux migrants qui empruntent la voie de la Turquie et du Soudan. Jusqu’à la frontière malienne et nigérienne.
Les Algériens se savent ciblés. Il suffit de revenir aux révélations de la revue « The Intercept » qui a mentionné la présence de 34 bases militaires américaines en Afrique. Leur hub principal étant le Niger, une des plus importantes bases en Afrique après le Camp Lemonnier de Djibouti. Cette base est située à Agadez, une base de drones c’est 700 hommes, située à 250 kilomètres de l’Algérie.

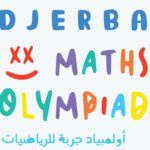




Le Maghreb reste une chimère et un rêve brisé pour les peuples maghrébins
A mon avis c’est l’Algérie qui est responsable de cette situation où l’animosité règne entre états, au lieu de la concorde et la coopération.
En effet par sa politique d’animosité au Maroc et de soutien au « Polisario » ou ce qu’elle appelle la « RASD » l’Algérie ne fait que briser ce rêve des maghrébins.
L’Algérie ou plutôt les généraux algériens ne veulent pas encore admettre les changements géo-stratégiques survenus dans le monde après l’effondrement de l’URSS qui dans le cadre de son soutien au « droits des peuples de disposer d’eux mêmes » soutenait cette entité fantoche pour contrecarrer l’influence occidentale en Afrique du nord.
Pour se construire le Maghreb n’a pas besoin d’un sixième état, mais de moins d’états