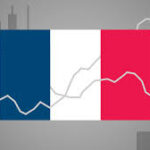Si l’école nous était contée. Elle a eu par le passé son heure de gloire grâce à l’abnégation et au dévouement d’hommes et de femmes qui l’ont hissée au sommet de l’olympe et remis le pays dans le sens de la marche de l’humanité après bien des siècles de ténébreux errements. Dieu a créé la terre et l’école a créé… la Tunisie moderne, celle des lumières.
Des instituteurs, souvent aux pieds nus, et des professeurs de lycées et collèges s’y sont pleinement investis, au prix d’énormes sacrifices, dans les campagnes les plus reculées et dans les faubourgs des grandes villes pour arracher de la pauvreté, de la misère et de l’ignorance l’écrasante majorité d’un pays exsangue au sortir de la nuit coloniale. Ils avaient pour eux leur courage et un patriotisme chevillé au corps. Si bien que peu de temps après, dans le concert des pays pré-émergents, la Tunisie triomphait grâce à ses maîtres d’école qui ont réussi à faire de la ressource humaine, dont on appréhendait le nombre des sans-emploi, notre principal facteur de développement.
L’essentiel du maigre budget de l’Etat était consacré à l’Education nationale. Non sans raison. Il ne pouvait y avoir meilleur investissement. La lutte contre l’analphabétisme, la généralisation de l’enseignement et la propagation de filières scientifiques et techniques nous avaient permis de prendre un véritable raccourci et nous a fait faire une énorme économie de temps. En si peu d’années, nous avons parcouru toutes les étapes de développement, là où d’autres pays, qui ont tourné le dos à l’éducation, avaient mis près d’un siècle pour y parvenir. L’école nous a délivrés très tôt des tabous et archaïsmes socioculturels et religieux qui nous enserraient dans le sous-développement, condition préalable à toute transformation économique et sociale. Avant d’amorcer à toute allure notre décollage économique qui a ouvert la voie à la marche vers la maturité industrielle et à la société de consommation qui est aujourd’hui la nôtre. Tout cela, en moins de vingt ans. L’école dans toute sa splendeur est passée par là. On comptait à l’aube des années quatre-vingt plus d’élèves et d’étudiants tunisiens dans les plus prestigieuses écoles et universités françaises que tous les étrangers réunis. On avait peine à imaginer qu’un très grand nombre d’entre eux soient issus de régions dans le plus grand dénuement, qu’il leur fallait la plupart du temps parcourir d’énormes, d’incertains et difficiles trajets par tout temps. Pour rejoindre à pied leurs classes perdues au fond des vallées ou nichées au flanc des montagnes, privées d’eau, d’électricité et de bien d’autres commodités si nécessaires en milieu scolaire. Les maîtres d’école étaient vénérés par tous. On leur devait respect, considération et gratitude. On disait d’eux qu’ils étaient – bien plus que les politiciens – la conscience du pays. Certains pour ne pas leur faire injustice le sont encore. Ils se savaient investis d’une difficile mission, celle de sortir le pays de l’ornière du sous-développement. Ils portaient en eux et incarnaient du mieux qu’ils le pouvaient un projet de société juste, tourné vers le progrès et la modernité. Ils mesuraient leur propre réussite à l’aune de celle de leurs élèves et étudiants. Ils ressentaient l’échec scolaire comme une épreuve personnelle. Ils avaient fait de l’école et du collège une sorte de sanctuaire dédié à la connaissance, loin des bruits et manigances des villes, du silence et de la résignation des campagnes. L’école devenait le symbole, l’emblème et la fierté du pays.
Ils sont loin les temps où les enseignants considéraient leur métier comme une sorte de sacerdoce. Ils étaient à la fois enseignants, éducateurs, guides et conseillers. Ils prenaient à leur charge les déficits et handicaps des familles et de la société qui étaient légion. Ils ne pouvaient imaginer un seul instant rompre les rangs ou arrêter les cours quels qu’en fussent les motifs. Enseigner est plus qu’un métier, c’est une mission, un contrat moral et un pacte pour la vie.
Dans la bourse des valeurs nationales, les enseignants avaient la cote, ils figuraient au plus haut niveau avant d’être rattrapés par le démon de la déraison d’une fédération syndicale qui veut faire de l’école une véritable arène politique pour gladiateurs des temps modernes. Il y a aujourd’hui comme un vent de folie qui souffle sur nos écoles, collèges et universités qui sont à la fois la matrice et le coeur battant de ce pays qui ne vit que par et pour l’école.
Les enseignants, hier, encensés, adoubés ne sont pas loin d’être aujourd’hui incriminés, accablés de tous les maux de la société. On comprend leurs difficultés, leurs frustrations et l’on est tout aussi convaincu qu’on n’en fera jamais assez pour eux au regard de la fonction et du rôle qui sont les leurs, mais il ne se trouvera aucune famille d’élèves ou d’étudiants ni personne d’ailleurs disposée à voir nos enfants sacrifiés sur l’autel de revendications catégorielles. Au-delà du désaccord, le conflit qui oppose la fédération du syndicat de l’enseignement secondaire et le ministre de l’Education nationale, livré à lui-même, a franchi la frontière de l’intolérable et porté atteinte à la sécurité nationale. On s’étonne de la passivité des têtes de l’exécutif, de l’ARP et des formations politiques aux prises avec leurs querelles existentielles face à un enjeu politique social et sociétal d’une telle importance. Plus de la moitié de la population est concernée par ce conflit qui tourne au drame national à cause de la menace d’une année blanche. La fédération, par la voix de son va-t-en-guerre le SG, intime l’ordre à ses adhérents enseignants de faire la grève des examens et des notes pour faire pression sur le gouvernement et le faire plier. Prendre en otage plus d’un million d’élèves par des enseignants qui sont censés leur faire gravir toutes les marches de la connaissance est pire qu’un crime, c’est une faute.
Qui sommes-nous et que sommes-nous devenus pour nous laisser entraîner jusqu’aux profondeurs des abîmes ? Comment se fait-il et pour quelles raisons le dernier sanctuaire de la cohésion sociale en arrive à s’autodétruire ? La panne prolongée de l’école publique, c’est aussi hélas, l’arrêt de l’ascenseur social. L’école serait-elle devenue une terrible machine à fabriquer les inégalités et l’exclusion sociale alors qu’elle a vocation à les gommer et à les bannir. Etudie aujourd’hui qui peut, cela voudrait signifier la mort programmée de l’école publique…
Le syndicat de base de l’Education nationale, tout comme celui de l’enseignement supérieur doivent savoir raison garder. Serait-ce trop leur demander ? On ne joue pas avec l’école comme à la roulette russe. Ils viennent de se tirer une balle dans les pieds et pourront se faire encore plus mal. Ils ont réussi l’exploit de provoquer, plus que la colère et l’indignation, le rejet des parents d’élèves et l’incompréhension de leurs sympathisants. Leurs revendications ne sont pas toutes légitimes et celles qui le sont ne peuvent être satisfaites d’un seul trait, dans l’immédiat. On ne peut remettre à niveau ici et maintenant écoles, collèges et lycées, lézardés, fissurés, délabrés par l’usure du temps, la passivité des dirigeants et le manque de moyens. Il faut certes dans l’immédiat remettre l’ouvrage sur le métier, mais les nécessaires aménagements prendront du temps avant que nos écoles et lycées fassent peau neuve et se hissent au niveau de dignité qui doit être la leur.
L’heure est grave et nul ne peut se dérober à ses propres obligations. La direction de la centrale ouvrière, dont on connaît la sagesse et le sens de la responsabilité, a aujourd’hui l’impérieux devoir de protéger le syndicat de ses propres excès et de ses dangereux dérapages. Il n’y a de pire ennemi du syndicalisme que le syndicalisme lui-même.
Le scénario de l’affrontement, de combats à l’issue incertaine ne mèneront nulle part sinon au désordre, au chaos, à la division et à la discorde. Les libertés et la démocratie chèrement acquises n’y gagneront rien. Il y a même à craindre une régression lourde de conséquences.
Le syndicat de l’enseignement a fait perdre aux enseignants l’aura, le respect et l’image qui étaient les leurs alors même qu’un grand nombre d’entre eux vivent cette situation comme un drame cornélien, sans s’y résoudre ni s’y reconnaître vraiment dans l’attitude syndicale. Les maîtres d’hier sont tombés de leur piédestal. Leur réputation est écornée et entachée et leur place dans la société s’est abîmée, au rythme où se dégrade l’enseignement en raison de l’immixtion et de l’intrusion de la politique et de l’idéologie dans les maternelles, les écoles et les lycées.
La société tunisienne ne s’y résoudra pas à cette décomposition de l’école publique. Elle s’en défendra. Elle n’acceptera pas de voir l’avenir de toute une jeunesse se fracasser contre les murs d’une école minée par l’intransigeance syndicale. Comble de l’ironie, c’est cette même école qui fut le porte-drapeau de notre ambition nationale. Rien n’est plus cher, ni n’a autant d’intérêt pour les parents que l’avenir assuré de leur progéniture. Qu’on se le rappelle, c’est cette même majorité silencieuse qui, en vingt-trois ans d’intervalle, a lâché Bourguiba et Ben Ali le jour où il lui est apparu l’arrêt de l’ascenseur social. Elle sanctionne à sa manière le fait que les jeunes diplômés – et c’est encore plus grave quand les enseignants les privent de diplômes – n’aient pas autant de chances d’ascension sociale qu’elle n’en a eu elle-même. A bon entendeur…
L’avertissement vaut pour tout le monde. Et plus encore pour le microcosme politique enfermé dans sa bulle, découplé et déconnecté de la planète Terre. On s’étonne de le voir s’enflammer et s’enthousiasmer au jeu de refondations politiques qui n’en finit pas d’en finir. Comme si ce big bang politique allait servir d’issue de secours, de sortie des crises économique, sociale, financière et plus grave encore celle de la dette aux effets ravageurs sur la croissance. On est pour le moins surpris de l’attitude plutôt festive et désincarnée de nos politiques qui ne voient rien venir de ce maëlstrom qui menace de faire chavirer le pays. Les parents d’élèves qui aujourd’hui crient leur colère voudraient eux aussi garder le sourire. Le pourraient-ils ?