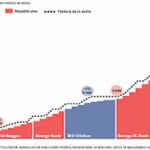Elle est ingénieur hydrique, docteur en science de la terre, experte en environnement, eau et changement climatique. Avec elle, on reviendra sur la situation hydrique en Tunisie, son impact sur l’agriculture avec la question de savoir si on doit faire le choix entre préserver notre agriculture ou nos ressources en eau. La réponse n’est pas de toute évidence. La sécheresse est un fait. Mais pour Mme Gafrej, plus que l’agriculture, c’est nous qui devons nous adapter en changeant de mode de vie, de mode d’alimentation.
Stress hydrique et agriculture. Quelle est la situation aujourd’hui ?
Actuellement, au jour d’aujourd’hui, le taux de remplissage des barrages est de 22%. C’est à peine suffisant pour à peu près deux mois d’alimentation en eau potable, sans donner une seule goutte de ces eaux de surface à l’agriculture. Pourquoi ai-je précisé eau de surface. Parce qu’il faut savoir que nous avons deux types d’agriculture : l’agriculture irriguée qui occupe 8% des terres agricoles utiles et le reste, soit 92% des terres agricoles, qui sont irriguées directement par les pluies.
C’est ce qu’on appelle l’agriculture pluviale. Sauf que, depuis quelques années, ce type d’agriculture pluviale n’existe plus vraiment. Avec l’augmentation des périodes de sécheresse, la majorité des agriculteurs se trouvent dans l’obligation de se débrouiller pour fournir l’eau à leurs plantations. Cela concerne particulièrement les oliviers, qui ne peuvent plus rester sans apport d’eau. Et c’est là que le bât blesse. Le ministère de l’Agriculture continue de nous dire que 75 à 80% de l’eau utilisée sont consacrés aux périmètres irrigués, soit 400 à 450 mille hectares. Or, ce n’est plus le cas. Il y a l’agriculture pluviale qui, désormais, consomme de l’eau. Une réalité que l’Etat ne reconnait pas, puisque les agriculteurs vont chercher de l’eau à droite et a gauche, dans les citernes, sans passer par les circuits officiels. En fait, l’Etat n’arrive plus à fournir l’eau et l’agriculteur ne peut pas délaisser ses cultures.
Quelque part, vous dites que c’est la fin de l’agriculture pluviale.
En fait, l’agriculture pluviale, si on veut qu’elle continue à subsister, il lui faut trouver l’eau. Cette eau doit venir de
quelque part. Si les eaux de surface ne sont plus disponibles dans les barrages, il y a deux alternatives. La première : réutiliser des eaux usées traitées, mais le potentiel est relativement faible par rapport aux besoins qui sont
gigantesques. Rien que pour les oliviers, on parle de deux millions d’hectares. L’autre alternative : le recours aux eaux souterraines. Or, elles sont fortement surexploitées et la qualité de l’eau se dégrade de plus en plus.
Alors, que faire ?
Le même problème se pose donc pour l’agriculture irriguée ?
Oui, en effet, le même problème se pose pour l’agriculture irriguée. Pour les 8% des terres agricoles irriguées utiles, la moitié concerne des périmètres publics. On parle de 250 mille hectares ; ils sont irrigués à 90% par les eaux de surface en provenance des barrages. C’est la cinquième année consécutive de sécheresse, et tout le monde connait la situation de nos barrages. Autrement dit, ces 250 mille hectares ne sont pas aujourd’hui irrigués. Que faire alors ? L’ancien ministre de l’Agriculture, M. Elyes Hamza, a autorisé les agriculteurs à créer des forages dans les périmètres publics irrigués, ce qui est formellement interdit. Ces périmètres ont été créés à partir d’une source pérenne qui est
l’eau de surface en provenance des barrages. Cela a été fait dans 14 gouvernorats du nord et du centre du pays.
C’est une surexploitation des eaux souterraines, surtout que l’autre moitié des terres irriguées, les terres privées, s’alimentent en eau exclusivement avec des forages privés. L’eau appartient toujours à l’Etat, mais le forage est privé. Résultat des courses : les forages sont asséchés et quand on trouve de l’eau, le taux de salinité est très élevé, avec un appel d’eau de mer, notamment pour les nappes côtières. C’est dire à quel point la situation est devenue complexe.
L’intégralité de l’entretien est disponible dans le Mag de l’Economiste Maghrébin n 883 du 6 au 20 décembre 2023