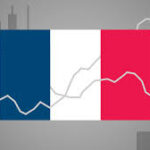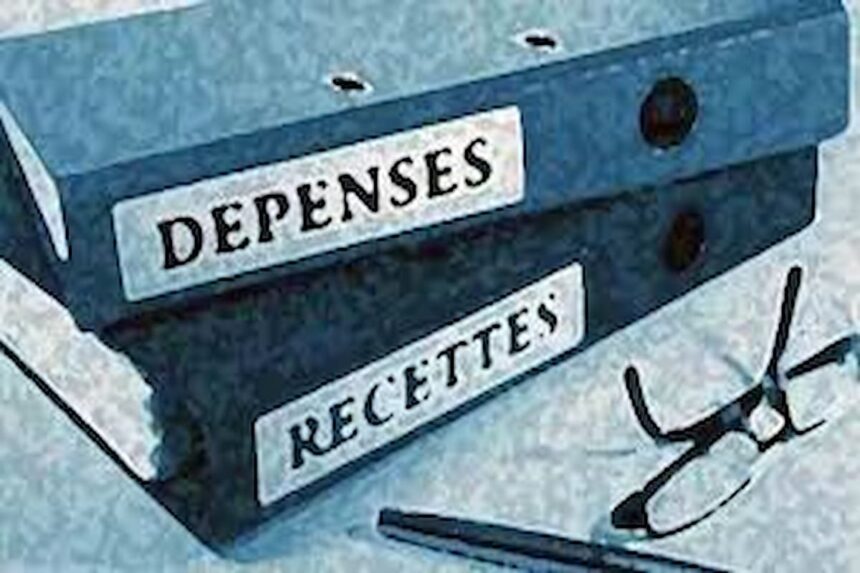Sur le papier, la discipline qui vise à limiter l’endettement public par rapport au PIB d’un pays semble efficace, car elle rassure les investisseurs en établissant des garde-fous contre les excès de dépenses des responsables politiques. Rassurer les marchés permet d’emprunter à des taux d’intérêt raisonnables, dans une logique où les dépenses de l’État devraient être proportionnelles aux recettes.
Cependant, le concept de déficit par rapport au PIB montre rapidement ses limites lorsque le pays fait face à une récession, nécessitant de la part de l’État des dépenses supplémentaires pour soutenir la demande. En théorie, dans un monde idéal, les périodes de croissance prolongée devraient être mises à profit pour équilibrer les comptes publics, voire pour générer des excédents.
Pourtant, cette règle a déjà été transgressée avant la crise, avec l’Allemagne à 66 %, la France à 64 % et l’Italie à 105 % de leur PIB entre 2003 et 2007.
En réalité, c’est en partie à cause de la dynamique européenne que cette notion de déficits par rapport au PIB est aujourd’hui remise en question. Dans l’Union européenne, les pays utilisant l’euro sont censés respecter un cadre strict où leur endettement public ne devrait pas dépasser 60 % de leur PIB. Pourtant, cette règle a déjà été transgressée avant la crise, avec l’Allemagne à 66 %, la France à 64 % et l’Italie à 105 % de leur PIB entre 2003 et 2007. Ces ratios ont évidemment explosé suite à la crise, atteignant respectivement 73 % pour l’Allemagne, 78 % pour la France et 116 % pour l’Italie en 2009.
Pour autant, aujourd’hui, l’Union européenne envoie un message clair au monde : cette règle ne fonctionne plus, même si les États-Unis l’ont précédée sur cette voie avec des ratios dépassant les 90 %. À leur décharge, les États-Unis n’ont jamais été soumis à une telle règle, qui semble irréaliste en période de turbulences.
Les partisans de cette théorie estiment que les problèmes structurels, comme le ralentissement, voire la stagnation ou une régulation financière inadéquate, sont responsables de la récession.
En ce qui concerne l’approche néokeynésienne – que je ne soutiens pas – en faveur d’une rigueur budgétaire stricte, elle reste néanmoins intéressante dans sa version Nouvelle Economie Keynésienne à la Joseph E. Stiglitz. Elle postule que l’endettement peut atteindre des sommets tant que la croissance est au rendez-vous pour en financer le coût.
Les partisans de cette théorie estiment que les problèmes structurels, comme le ralentissement, voire la stagnation ou une régulation financière inadéquate, sont responsables de la récession. Ils soutiennent que le redémarrage de la croissance pourrait justifier, voire compenser, les excès d’endettement contractés aujourd’hui.
N’est-il pas temps, dans le contexte tunisien, de s’interroger sur ces enjeux afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’investissements publics pour favoriser le développement et l’exigence de maintenir une discipline budgétaire qui rassure les investisseurs et garantit la soutenabilité de la dette à long terme ?
===============================
* Dr. Tahar EL ALMI,
Economiste-Economètre.
Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,
Psd-Fondateur de l’Institut Africain
D’Economie Financière (IAEF-ONG)